Les tâtonnements de l’identité suisse romande
« Utiliser ce qu’on a d’abord, et utiliser ce qu’on est... »
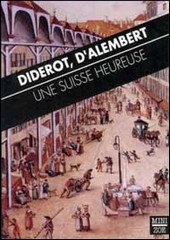 Un « décalage fécond », c’est ainsi que le critique genevois Jean Starobinski définit la position des écrivains suisses de langue française. Mais avant que la littérature suisse romande s’affirme en tant que telle, produise ses propres références et développe un système autosuffisant - des éditeurs, des critiques, un public - il se sera écoulé des siècles de trouble et d’hésitation, d’interrogations sur une identité paradoxale, à la limite de la schizophrénie. Intellectuellement, culturellement, les Suisses romands vivent tournés vers la France et donc vers Paris, tout en dépendant politiquement de Berne. Comment vivre avec ce strabisme divergent ? Que faire de ces différences dans l’expression, dans la manière d’être, dans la vision du monde, d’autant plus gênantes qu’elles sont infimes ? Ramuz remarque, dans Paris, notes d’un Vaudois :
Un « décalage fécond », c’est ainsi que le critique genevois Jean Starobinski définit la position des écrivains suisses de langue française. Mais avant que la littérature suisse romande s’affirme en tant que telle, produise ses propres références et développe un système autosuffisant - des éditeurs, des critiques, un public - il se sera écoulé des siècles de trouble et d’hésitation, d’interrogations sur une identité paradoxale, à la limite de la schizophrénie. Intellectuellement, culturellement, les Suisses romands vivent tournés vers la France et donc vers Paris, tout en dépendant politiquement de Berne. Comment vivre avec ce strabisme divergent ? Que faire de ces différences dans l’expression, dans la manière d’être, dans la vision du monde, d’autant plus gênantes qu’elles sont infimes ? Ramuz remarque, dans Paris, notes d’un Vaudois :
« Paris est malgré tout une ville cosmopolite : un Russe n’y étonne pas, on devine tout de suite qu’il est Russe. Un Marseillais, un Auvergnat y sont chez eux, ils sont classés. Ils font partie des apports de la province ; mais nous autres, nous ne sommes pas des provinciaux. Quoique avec un accent souvent plus faible et moins marqué, nous surprenons par une certaine inflexion de langage, par d’infiniment petites nuances, par les mots dont nous nous servons, par notre démarche sans doute aussi, notre attitude, notre allure, conséquences et effets de choses très profondes, dont nous ne nous étions pas rendu compte encore, faute d’occasion, et que nous étalons ainsi naïvement. »
La tentation de l’escamotage
Dans Le droit de « mal écrire » - Quand les auteurs romands déjouent le « français de Paris », Jérôme Meizoz retrace ces longues tergiversations collectives. Il cite un historien de la littérature, au début du siècle, s’écriant : « Soyons d’excellents Suisses, mais fanatiques du meilleur français ! N’ayons pas le culte exclusif de nos petites originalités ! »
Les verdicts condescendants tombant de la métropole culturelle n’étaient pas pour encourager au batifolage linguistique. Toute affirmation d’une identité propre, tout signe un peu trop distinctif reléguait impitoyablement un écrivain aux enfers du folklore. Pour avoir pris la défense d’un roman du Genevois Rodolphe Töpffer (écrivain, peintre et fondateur de la bande dessinée moderne), Sainte-Beuve s’attira en 1841 les foudres de Gustave Planche, du Charivari, que cite également Meizoz :
« Sainte-Beuve a perdu toute ma confiance : son dernier article sur un certain Tropfer, Tapfer, ou Topfer, est complètement au-dessous de la critique... Ce Tropfer me semble un vrai cuistre de province, propre tout au plus à écrire des chroniques dans le journal de son département. »
Dès lors, pour un écrivain, la tentation est grande de minimiser les différences, de gommer ses « petites originalités » et de calquer son expression sur celle des Français. Si c’est le prix à payer pour toucher un public plus important, il pourrait même paraître, au premier coup d’œil, assez dérisoire. Et cet escamotage sera d’autant plus aisé que, pour un romancier nourri de littérature française, situer son action à Paris relève pratiquement du réflexe. Y perdra-t-on quelque chose d’essentiel ? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c’est que si l’auteur sait qui il est et d’où il parle, s’il l’assume, même s’il n’en fait pas étalage, l’œuvre ne pourra qu’y gagner. Dans Raison d’être, Ramuz a cette réflexion fulgurante :
« On ne va au particulier que par amour du général et pour y atteindre plus sûrement. »
Elargir le champ d’une langue
Ramuz, qui vécut douze ans à Paris, est sans doute celui qui a le plus réfléchi à ces questions, parce qu’il y a été confronté de manière très concrète. Son séjour prolongé n’a en rien diminué sa fascination pour ce Paris « qu’on entendait sans cesse sans le savoir au fond de soi, depuis les tout premiers livres d’images où son nom figurait déjà » (Raison d’être). Mais Paris lui a en même temps livré la clé de sa propre identité, le poussant résolument à s’affirmer et non à s’assimiler. Il raconte ce processus dans Paris, notes d’un Vaudois. Paris est le centre absolu, le lieu où convergent tous les regards et qui dicte la norme, le lieu où enfin on peut cesser de tourner les yeux vers un ailleurs pour y puiser ses références ; Paris est d’une « parfaite indépendance ». Les Suisses en général et les Vaudois en particulier (Ramuz est vaudois) s’expriment avec hésitation, doutant à la fois, dit l’écrivain, de ce qu’ils veulent dire et de ce qu’ils sont, « car les deux choses n’en sont qu’une et on ne sait pas ce qu’on va dire quand on ne sait pas ce qu’on est ». Or à Paris, on s’exprime sans se poser de questions, avec intrépidité, en adéquation parfaite et immédiate avec la pensée, « de sorte que la formule continue à vivre extérieurement de la vie même qu’elle avait au-dedans de vous ». Ramuz écrit :
« C’est ce que me disaient Mme Sérieux dans sa jolie langue, M. Coudray l’épicier, M. Colombel l’herboriste et M. Rabardel chez qui chaque jour j’allais prendre mes deux repas, les passants dans la rue, mes voisins de table à la terrasse d’un café : tous ils m’enseignaient la liberté de l’expression, et de m’inspirer non de cette expression, mais de cette liberté.
C’est Paris lui-même qui m’a libéré de Paris. Il m’a appris dans sa propre langue à me servir (à essayer du moins de me servir) de ma propre langue. Car il faut distinguer entre ses leçons immédiates et celles qui agissent en profondeur : dont la plus profonde est sans doute qu’étant étonnamment lui-même, il vous enseigne à être soi-même. Il a obéi à certaines lois : il vous enseigne à obéir aux vôtres. »
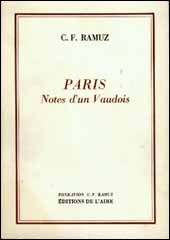 Cette liberté dont s’empare Ramuz préserve la littérature de l’enfermement, du fonctionnement en circuit fermé. Elle la maintient en connexion avec la vie dans tous ses recoins, enrichit la langue, l’assouplit, élargit son répertoire, le champ de ce qu’elle peut exprimer. Elle permet de « maintenir du primitif en circulation libre » - conseil que donnait le poète suisse Maurice Chappaz à son jeune confrère Jean-Marc Lovay dans leur recueil de correspondance, La tentation de l’Orient. La littérature suisse joue ce rôle pour la langue française, comme la littérature belge, africaine, québécoise. Jérôme Meizoz cite André Brincourt, dans Langue française, terre d’accueil : « Une vraie chance que les barbares nous bousculent avec nos propres mots ! »
Cette liberté dont s’empare Ramuz préserve la littérature de l’enfermement, du fonctionnement en circuit fermé. Elle la maintient en connexion avec la vie dans tous ses recoins, enrichit la langue, l’assouplit, élargit son répertoire, le champ de ce qu’elle peut exprimer. Elle permet de « maintenir du primitif en circulation libre » - conseil que donnait le poète suisse Maurice Chappaz à son jeune confrère Jean-Marc Lovay dans leur recueil de correspondance, La tentation de l’Orient. La littérature suisse joue ce rôle pour la langue française, comme la littérature belge, africaine, québécoise. Jérôme Meizoz cite André Brincourt, dans Langue française, terre d’accueil : « Une vraie chance que les barbares nous bousculent avec nos propres mots ! »
Ramuz, dans son œuvre, montre un attachement constant à cette relation entre le monde physique, perçu sans intermédiaire, et le monde intellectuel. Il faut lire les premières pages de Raison d’être, qui sont une sublime description de la condition d’écolier, de son dépaysement mortel ; l’écolier enfermé dans une salle de classe alors qu’il vient à peine de s’ouvrir aux choses, et qui, plus tard, lorsqu’on lui rend sa liberté, a pris goût à « la page imprimée », mais ne voit plus le monde qui l’entoure. Un rendez-vous manqué d’autant plus sûrement, pour les petits écoliers suisses, que ce n’est pas au monde qui les entoure que fait référence la page imprimée. Si l’un de ces enfants veut un jour devenir écrivain, il ne lui viendra certainement pas à l’idée de situer son intrigue ailleurs qu’à Paris.
Une identité floue dans un monde net
Il faut donc affronter cette grande inconnue : qui est-on ? C’est la question jamais résolue, la question qui rend hésitant lorsqu’il faut parler. Le « décalage fécond » n’est pas seulement décalage avec la France, il est aussi décalage avec soi-même. « Cette langue [le français], nous devrons la regarder, l’arracher un peu de nous pour la maîtriser », dit l’écrivain romand Etienne Barilier, cité par Jérôme Meizoz. Ce sont aussi ces certitudes interdites, cette interrogation perpétuelle de sa propre identité - aidées par une nature omniprésente qui renvoie à soi-même, et par la sérénité qui règne dans le pays - qui ouvrent les grands espaces intérieurs dont la littérature suisse est si riche.
Le monde est assez net, vu de cet espace minuscule, de ce « poste avancé », ce « lieu abstrait », cette « cabine vitrée » (pour reprendre les termes qu’Alice Rivaz applique à l’appartement de son héroïne romancière) surplombant l’Europe. La frontière n’est jamais très loin dans un si petit pays, pour peu qu’on ne vive pas trop à l’intérieur, au milieu des montagnes ; le point de vue est imprenable. L’absence de culture propre affirmée, homogène, voire l’autodénigrement permanent, interdisent toute suffisance, toute certitude. Ils rendent assez sensible à ce qui se passe à l’extérieur, laissent le champ libre pour s’exprimer à des cultures étrangères plus exubérantes, héritées de l’immigration. Le monde est net, familier ; il est à la fois dedans et dehors, à portée de la main, et le désir d’aller l’expérimenter, plutôt répandu, peut se réaliser assez facilement - le cours du franc suisse aidant parfois (si on veut bien me pardonner ce prosaïsme). Nicolas Bouvier, Ella Maillart, avant eux Blaise Cendrars, sont les plus célèbres de ceux qui ont déjà répondu à cet appel. Le monde est donc net, mais soi-même on est flou. Ramuz encore, dans Notes d’un Vaudois toujours :
« N’oublions pas que nous sommes sur toutes les frontières : celles de trois langues et de trois grandes civilisations, celle de deux dialectes, oc et oïl ; posés au point précis où les eaux hésitent entre le Rhône et le Rhin ; car peut-être que cet embarras ne va pas sans une certaine richesse ; peut-être suppose-t-il justement un grand nombre de possibilités entre lesquelles nous avons à choisir. »
Au maître aussi le mot de la fin :
« Nous ne sommes chacun qu’un tout petit morceau du monde : ce qu’il importe seulement c’est que chacune de ces infimes parties du monde prenne conscience de l’ensemble où elle se trouve engagée, tout en sauvegardant son autonomie. On va trop vite, allons lentement : ainsi l’équilibre sera rétabli. (...) Utiliser ce qu’on a d’abord, et utiliser ce qu’on est et avec des moyens à soi, c’est le conseil que me donnait Paris, au moment même où je le quittais. »
Merci à Irina Cotseli
C.-F. Ramuz, Paris, notes d’un Vaudois, éditions de l’Aire (Pully). A lire aussi pour l’analyse passionnante que fait l’auteur des relations Paris/province(s).
Jérôme Meizoz, Le droit de « mal écrire » - Quand les auteurs romands déjouent le « français de Paris », éditions Zoé (Genève).
Fritz Zorn, Grisélidis Réal, Alice Rivaz, Robert Walser : panorama subjectif de la littérature suisse
Sur le(s) même(s) sujet(s) dans Périphéries :
- * Et vous, quel travail feriez-vous si votre revenu était assuré ? - Revenu garanti, « la première vision positive
du XXIe siècle » - décembre 2010 - * Dernières nouvelles de l’imaginaire du monde - Trigon-film, distributeur suisse spécialisé dans les films du Sud - août 2001
- * « Quand on s’investit dans un lieu, il devient vivant » - L’Ilot 13, un périmètre alternatif à Genève - juin 2001
- * Iso Camartin en son esplanade - 16 avril 2001
- * Les poèmes de Nicolas Bouvier - 23 mars 2001
- * Robert Walser, la bonté impitoyable - 22 juillet 2000
- * Post-scriptum au panorama de la littérature suisse - 9 avril 2000
- * Après les élections législatives en Suisse - 2 novembre 1999
- * I am called a plant - 20 juin 1999
- * Entre introspection et subversion - Littérature suisse - mars 1999
- * Human Bomb - Carlo Brandt, comédien suisse - janvier 1998






