Révolte et mélancolie, de Michaël Löwy et Robert Sayre
Chine trois fois muette, de Jean-François Billeter
Eloge du relativisme historique
Il est devenu aujourd’hui banal de constater la prise de pouvoir de l’économique sur le social, en général pour la déplorer. Mais, en posant le problème en termes moraux, on le prive trop souvent de son historicité : on oublie que la grande force du système, celle qui explique sa longévité, est de parvenir à donner l’illusion de sa « naturalité », en se présentant comme la grève sur laquelle toute société humaine est destinée à échouer tôt ou tard. Dans Chine trois fois muette (2000), Jean-François Billeter retrace le long processus au fil duquel, à partir de la Renaissance, en Europe, la façon qu’avaient les marchands de voir le monde est devenue la vision universellement partagée, aboutissant à « soumettre l’infinie profondeur et variété du social aux abstractions de la raison marchande ». Cette confusion entre raison instrumentale et raison tout court nous prive du moyen d’agir sur le développement autonome du capitalisme, car elle reste largement inconsciente. Or, en lisant Révolte et mélancolie - Le romantisme à contre-courant de la modernité , de Michaël Löwy et Robert Sayre (1992), on s’aperçoit que les romantiques, eux, l’ont identifiée très tôt. Sayre et Löwy considèrent même le romantisme comme étant « par essence une réaction contre le mode de vie en société capitaliste ». Leur thèse est que, le capitalisme n’ayant pas disparu, le romantisme, qui lui est « coextensif », perdure lui aussi, comme un courant clandestin de notre vie culturelle ; un courant qu’il pourrait être plus utile que jamais d’identifier, à une époque où l’on voit s’amorcer la mise à nu du capitalisme comme idéologie parmi d’autres. Partant d’objets d’étude très différents, ces deux livres invitent à prendre conscience des relais que trouve le système dans les dispositions mentales dont nous avons hérité, afin de pouvoir enfin s’en déprendre, le démystifier, et recommencer à exercer notre « liberté d’instituer ».
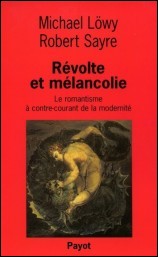 Ce sont deux livres qui, a priori, n’ont rien à voir l’un avec l’autre, et qui disent pourtant, quoique par des biais très différents, la même chose. Le premier, Révolte et mélancolie - Le romantisme à contre-courant de la modernité, signé par deux sociologues, Michaël Löwy et Robert Sayre, et publié en 1992, formule l’hypothèse que le romantisme serait, dans son essence même, anticapitaliste ; les auteurs situent ses premières manifestations au milieu du XVIIIe siècle, « lorsque la grande industrie commence à prendre son essor et que le marché se dégage de l’emprise sociale ». Ainsi, selon eux, puisque le capitalisme perdure, le romantisme perdurerait lui aussi, comme un courant idéologique clandestin de notre vie culturelle, que l’on aurait tout intérêt à identifier et à assumer pour le renforcer - puisque, affirment-ils, « l’utopie sera romantique ou ne sera pas ».
Ce sont deux livres qui, a priori, n’ont rien à voir l’un avec l’autre, et qui disent pourtant, quoique par des biais très différents, la même chose. Le premier, Révolte et mélancolie - Le romantisme à contre-courant de la modernité, signé par deux sociologues, Michaël Löwy et Robert Sayre, et publié en 1992, formule l’hypothèse que le romantisme serait, dans son essence même, anticapitaliste ; les auteurs situent ses premières manifestations au milieu du XVIIIe siècle, « lorsque la grande industrie commence à prendre son essor et que le marché se dégage de l’emprise sociale ». Ainsi, selon eux, puisque le capitalisme perdure, le romantisme perdurerait lui aussi, comme un courant idéologique clandestin de notre vie culturelle, que l’on aurait tout intérêt à identifier et à assumer pour le renforcer - puisque, affirment-ils, « l’utopie sera romantique ou ne sera pas ».
 Le second, Chine trois fois muette, est un court essai du sinologue Jean-François Billeter, paru en 2000. Il retrace le long processus qui s’est déroulé sur le continent européen depuis la Renaissance, et qui aboutit, au moment de la Révolution industrielle, à une interversion de l’économique et du social : l’économique, qui jusque-là lui avait toujours été subordonné, « se soumet le social et lui dicte sa loi ». C’est l’analyse de Karl Polanyi - à qui Sayre et Löwy se réfèrent également - dans La grande transformation : « Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, écrit Polanyi, l’économique, sous la forme du marché autorégulateur, devient autonome et dominateur par rapport à l’ensemble des institutions sociales ; en même temps, au niveau de la psychologie sociale, un parmi les multiples mobiles d’action dans les sociétés antérieures (coutume, droit, magie, religion, etc.) acquiert la primauté : celui du gain. » La société devient tout entière « un appendice du système économique ». Comme le résument Sayre et Löwy, « ce qui était auparavant un moyen devient une fin en soi ; ce qui était une fin devient un simple moyen ».
Le second, Chine trois fois muette, est un court essai du sinologue Jean-François Billeter, paru en 2000. Il retrace le long processus qui s’est déroulé sur le continent européen depuis la Renaissance, et qui aboutit, au moment de la Révolution industrielle, à une interversion de l’économique et du social : l’économique, qui jusque-là lui avait toujours été subordonné, « se soumet le social et lui dicte sa loi ». C’est l’analyse de Karl Polanyi - à qui Sayre et Löwy se réfèrent également - dans La grande transformation : « Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, écrit Polanyi, l’économique, sous la forme du marché autorégulateur, devient autonome et dominateur par rapport à l’ensemble des institutions sociales ; en même temps, au niveau de la psychologie sociale, un parmi les multiples mobiles d’action dans les sociétés antérieures (coutume, droit, magie, religion, etc.) acquiert la primauté : celui du gain. » La société devient tout entière « un appendice du système économique ». Comme le résument Sayre et Löwy, « ce qui était auparavant un moyen devient une fin en soi ; ce qui était une fin devient un simple moyen ».
Un système qui a la capacité
de se rendre invisible
Le diagnostic n’a rien d’original ; sauf, que, le plus souvent, on se contente d’appréhender l’hégémonie de l’économie sur un registre moral, pour la déplorer comme une fatalité, en la privant de son historicité. Or, Billeter montre que ce renversement est indissociable d’un phénomène plus large : il est rendu possible par une mutation de la pensée qui détermine la mentalité y compris des opposants les plus sincères à l’économie toute-puissante. Cette mutation, il la voit s’amorcer à la Renaissance : le rapport qu’entretiennent les marchands avec leurs marchandises, ce rapport « abstrait, quantifié, calculé », devient d’abord le point de vue duquel ceux-ci se mettent à envisager la société et le monde, puis le point de vue duquel l’ensemble de la société et du monde se met à envisager la société et le monde. On voit s’étendre aux techniques, aux sciences, aux arts, et finalement devenir l’instrument unique d’appréhension du monde, une forme de raison que l’on prend pour une raison autonome, mais qui est une raison marchande « par son origine et dans son essence ». Il en découle ce que Billeter appelle une « réaction en chaîne », qui a pu s’étendre à la planète entière - y compris, aujourd’hui, à la Chine - parce que personne n’en avait conscience : « Cette réaction en chaîne ne pourra être arrêtée que lorsque ce mécanisme aura été généralement reconnu. » Car la primauté de l’économique sur le social est un avatar historique, qui est apparu et peut donc disparaître, mais qui n’a aucun mal à se maintenir et à se présenter comme éternel et « naturel », puisqu’il repose aussi sur les dispositions mentales dont ont hérité ceux qui le contestent. Son abolition relève donc moins d’un vœu pieux, comme on peut en avoir l’illusion, que d’un travail qui ne peut commencer que par une lente prise de conscience - un peu comme quand, au cours d’une psychanalyse, l’examen intellectuel de ses réflexes conditionnés et de leurs ressorts cachés conduit peu à peu le patient, insensiblement, à modifier son comportement de façon à sortir des ornières existentielles où il s’enlisait. « Nous ne concevons pas la possibilité d’une telle reconfiguration, écrit Billeter, parce que la forme de raison qui domine notre époque la rend inimaginable. »
Chine trois fois muette nous rappelle L’islam, les Arabes et nous, de Jacques Berque et Jean Sur (Mille et une nuits) : là aussi, un manifeste politique aussi succinct qu’essentiel se dissimule sous l’apparence d’un petit essai savant sur une culture mal connue. Mais cette similitude n’est pas que de forme : c’est Jean Sur qui nous a mis sur la piste de Jean-François Billeter ; et Jacques Berque, lui aussi, récusait « l’inversion » entre l’économique et le social détaillée par le sinologue, disant par exemple, dans Il reste un avenir (Arléa) : « C’est l’homme qui doit être le premier et le dernier, c’est par l’homme que ça doit commencer et que ça doit finir. Voyons-nous quelque part une sommation sociale ou diffuse de la morale publique à cet égard ? Voyons-nous une autorité quelconque s’inquiéter de cet assassinat ? Sous couleur de rentabilité, on détruit cet homme qui est le destinataire de cette rentabilité. On renverse. Supposez un cavalier sur sa monture et renversez l’image. Le cavalier prend son cheval sur ses épaules. Il en est ainsi de l’économie actuelle. » Au passage, il faisait remarquer (ces entretiens se déroulaient juste après le oui français à Maastricht) que la construction européenne se faisait conformément à ce renversement, et que cette manière de procéder ne pouvait être innocente : « Par ordre d’importance, c’est de la monnaie qu’on s’est occupé, puis de l’économie, puis de diverses sortes d’organismes, jamais de la culture et encore moins de l’identité. C’est ce que j’appelle l’ordre des réalités renversé. Un jour, peut-être, nous remettrons l’Europe sur ses pieds. »
Les romantiques contre
le dévoiement de la raison
Billeter estime donc que « la réaction en chaîne déploie ses effets parce que ses acteurs n’ont pas conscience de son mécanisme, de sa façon cachée de leur imposer sa loi ». Peut-être devrait-il toutefois excepter de cette affirmation les romantiques, dont Sayre et Löwy écrivent qu’eux seuls ont su « toucher à ce qui était l’impensé de la pensée bourgeoise » - et c’est pourquoi leur héritage est si précieux aujourd’hui, alors que cet impensé persistant provoque des dégâts de plus en plus évidents : « Ils ont vu ce qui était en dehors du champ de visibilité de la vision libérale individualiste du monde : la réification, la quantification, la perte des valeurs humaines et culturelles qualitatives, la solitude des individus, le déracinement, l’aliénation par la marchandise, la dynamique incontrôlable du machinisme et de la technologie, la temporalité réduite à l’instantané, la dégradation de la nature. » Les romantiques ont toujours été conscients de ce dévoiement de la raison par la vision marchande et utilitariste que décrit Billeter. Sayre et Löwy récusent l’hypothèse simpliste selon laquelle le romantisme, comme on le croit souvent, serait une réaction aux Lumières, un refus immature de la raison ; les romantiques, écrivent-ils, s’ils veulent effectivement explorer et valoriser des « sphères psychiques non réductibles à la raison » (ce qui ne revient pas à nier cette dernière), cherchent plutôt à « opposer à la rationalité instrumentale - au service de la domination sur la nature et sur les êtres humains - une rationalité humaine substantielle ». S’ils critiquent les Lumières, c’est dans ceux de leurs aspects qui sont moins liés au triomphe sur l’obscurantisme qu’à la « nouvelle réification de la vie ». Sayre et Löwy ont donc raison d’accorder toute leur attention aux auteurs qui voient dans le romantisme, non pas une manifestation réactionnaire, mais au contraire « une radicalisation, une transformation-continuation de la critique sociale des Lumières » : une tentative, tout en prenant acte du progrès qu’elles ont représenté, d’endiguer leurs effets pervers, que les romantiques sont seuls à voir.
Outre le « refus de l’abstraction rationaliste », Sayre et Löwy dégagent quelques thèmes essentiels du romantisme : celui du désenchantement du monde (à ce sujet, voir sur ce site : « Le sentiment océanique à l’assaut du rationalisme ») ; celui de la quantification, qui éradique toute valeur qualitative ; celui de la mécanisation, et de l’assimilation de l’être humain lui-même à une machine, alors que « les plus grandes conquêtes de l’humanité n’étaient pas mécaniques mais dynamiques, mues par une aspiration infinie » ; et enfin celui de la dissolution des liens sociaux : « une conscience aiguë de la détérioration radicale de la qualité des rapports humains dans la modernité, et la recherche nostalgique de la communauté authentique ». Ce dernier thème est lié à la nostalgie de l’unité ou de la totalité : « L’individu romantique est une conscience malheureuse, malade de la scission, cherchant à restaurer des liens heureux, seuls à même de réaliser son être. » Certes, il valorise sa propre subjectivité, c’est-à-dire qu’il s’approprie un bénéfice de la modernité qui rend d’autant plus virulente sa critique d’autres de ses aspects : « Le capitalisme suscite des individus indépendants pour remplir des fonctions socio-économiques ; mais quand ces individus se muent en individualités subjectives, explorant et développant leur monde intérieur, leurs sentiments particuliers, ils entrent en contradiction avec un univers fondé sur la standardisation et la réification. » Mais, s’il tient à sa marge de manœuvre personnelle, le sujet romantique aspire aussi, et de manière indissociable, à une communauté heureuse - alors que la modernité capitaliste annihile toutes les formes de sociabilité pour mieux « détacher » les êtres humains à son service -, en même temps qu’à une inscription harmonieuse dans l’univers naturel - que le capitalisme exploite et saccage en le réduisant à un ensemble d’utilitaires. « Le paradis perdu est toujours la plénitude du tout - humain et naturel. »
Les crimes du XXe siècle sont
« intimement liés,
dans leur forme et leur contenu,
à la modernité industrielle »
Sayre et Löwy n’ignorent pas que le romantisme est un « hermaphrodite politique », dont ont pu se réclamer aussi bien les conservateurs que les révolutionnaires : ils consacrent de longues pages, parfois un brin fastidieuses mais nécessaires, à distinguer et détailler ses nombreux courants. Ils rejettent l’accusation selon laquelle le romantisme serait d’essence fasciste ou nazie : ils jugent plus approprié de parler, au sujet de ces idéologies, de « modernisme réactionnaire ». Même si le nazisme a certes « puisé dans l’arsenal culturel du romantisme » (les mythes, la nostalgie de la nature, la grandeur du passé...), il revêtait avant tout une dimension « moderne, industrielle et technologique » : « Rappelons le rôle crucial joué par l’industrie, particulièrement militaire et paramilitaire, et les “usines de la mort” qu’étaient les camps de concentration... » Billeter, lui aussi, fait remarquer que le monde, après guerre, a préféré considérer les crimes nazis comme une monstruosité inexplicable, sans voir que leurs auteurs avaient plutôt « franchi un dernier pas dans l’assujettissement de l’homme à la logique de la révolution industrielle, c’est-à-dire à la raison économique ». Il rappelle ces mots de Primo Levi, l’un des seuls, dit-il, à avoir perçu la continuité entre le système économique et les camps de concentration : nous devons observer les relations sociales dans les camps « si nous voulons simplement nous rendre compte de ce qui se passe dans un grand établissement industriel ». Même analyse chez Sayre et Löwy : « La force de l’idéologie du progrès est telle que l’on décrit toujours les horreurs du XXe siècle comme des “régressions”, des “rechutes dans la barbarie”. Or, ces événements sont intimement liés, dans leur forme et leur contenu, à la modernité industrielle. » Mais cette interprétation, remettant en cause un système qui était commun aux Allemands et à leurs adversaires, a été refoulée ; et, au sortir de la guerre, écrit Billeter, les Etats-Unis sont apparus « comme les hérauts d’un capitalisme jeune et innocent, lavé de ses stigmates par sa victoire sur les forces du mal ». Aujourd’hui, ajoute-t-il, « la société américaine domine parce qu’elle est elle-même dominée plus qu’aucune ne l’a jamais été par la raison économique ». Il explique cette vulnérabilité particulière à la « réaction en chaîne » par le fait qu’aux Etats-Unis, « aucun héritage historique n’a ralenti ou compliqué le développement de la raison économique ».
La guerre froide, quant à elle, peut être vue comme un affrontement factice, qui a surtout permis aux deux blocs de renforcer leurs pouvoirs respectifs en brandissant chacun la menace représentée par l’autre. Il s’est produit une « connivence de fait dans le maintien d’un ordre social et d’un ordre du monde fondé sur une même logique économique », constate Billeter. Les sociétés de type soviétique « n’ont en aucun cas effectué une véritable rupture avec la civilisation capitaliste », renchérissent Sayre et Löwy, qui livrent une analyse passionnante des rapports entre marxisme et romantisme, estimant que l’on peut considérer le second comme une « source oubliée » du premier. Marx lui-même n’était en effet pas insensible au romantisme, dont il appréciait et relayait les puissantes critiques du capitalisme. C’est surtout perceptible dans ses écrits de jeunesse, qui s’en prennent à l’appauvrissement de la sensibilité humaine en société capitaliste : il déplore par exemple que les hommes développent exclusivement leur sens de la possession, tel un marchand de pierres précieuses qui « voit uniquement leur valeur marchande, et non la beauté ou la nature particulière des pierres ». Dans Le Capital, il dénonce la division du travail, citant un écrivain romantique conservateur : « Subdiviser un homme, c’est l’exécuter. » Sayre et Löwy ont aussi bien repéré ce passage des Grundrisse qui, quelques années plus tard (Révolte et mélancolie, rappelons-le, est sorti en 1992), servira de référence aux théoriciens du revenu garanti : Marx y formule l’hypothèse que le progrès technique, dans la communauté socialiste, réduira drastiquement le temps de travail nécessaire à satisfaire les besoins fondamentaux, autorisant chacun à consacrer la plus grande partie de son temps à ce qu’il appelle le « travail attractif », celui qui permet l’épanouissement de l’individu. Ce qui serait une bonne manière de rétablir la primauté du social sur l’économique... Billeter, qui voit dans le salariat, dans la nécessité de « se vendre » pour assurer sa subsistance, l’un des principaux verrous mis en place par la raison marchande, évoque lui aussi, comme moyen d’en sortir, l’« allocation universelle de base », et renvoie aux travaux d’André Gorz sur le sujet.
La répudiation du
romantisme « bourgeois » :
l’erreur des marxistes
C’est aussi lui qui pointe - à la suite de Karl Polanyi, là encore - en quoi Marx est resté impuissant à rompre en profondeur avec le système capitaliste : en acceptant et en accréditant l’idée que l’économie était « une réalité autonome, le soubassement objectif de toutes les sociétés humaines ». Quoi qu’il en soit, avec le temps, on verra s’imposer un marxisme radicalement antiromantique et « inconditionnellement admirateur du progrès capitaliste-industriel ». Pour les idéologues marxistes, le romantisme est à vouer aux gémonies, car « bourgeois ». C’est là ce que Sayre et Löwy appellent une « déformation dogmatique, qui refoule violemment les affinités entre le marxisme et le romantisme ». Non seulement ses tenants commettent une erreur de jugement en sous-estimant la portée subversive du romantisme, mais ils se privent d’un moyen de lutte qui pourrait être décisif, car la critique romantique du capitalisme a la caractéristique de porter sur ceux de ses effets négatifs qui « traversent les classes sociales ».
Certains auteurs ont avancé l’hypothèse que les romantiques étaient des déclassés, aristocrates dépossédés ou jeunes bourgeois privés de débouchés professionnels ; leur haine du capitalisme aurait alors été une haine d’amoureux déçus, en quelque sorte. Or, expliquer l’adhésion à la vision romantique par la seule coalition d’intérêts, c’est encore rester prisonnier de cette raison économique qui considère l’être humain uniquement comme une « machine cupide » - selon la belle expression du romantique anglais John Ruskin -, et qui lui dénie tout autre moteur existentiel. Sayre et Löwy jugent l’explication insuffisante pour justifier « la violence et la profondeur de cette mise en cause de tout un ordre socio-économique », et en fournissent une autre, plus convaincante : les romantiques étaient certes souvent des bourgeois, mais des bourgeois qui, faisant partie de l’intelligentsia (écrivains, théologiens, artistes...), « vivaient dans un univers mental régi par des valeurs qualitatives, des valeurs éthiques, esthétiques, religieuses, culturelles ou politiques » : ils ne pouvaient donc que se sentir profondément heurtés par le système capitaliste, qui, en propageant l’aliénation et la réification, signifiait le triomphe des valeurs quantitatives, et la négation de tout ce en quoi ils croyaient, de tout ce qui leur était d’une importance vitale. Si certains de leurs confrères s’adaptèrent au nouvel ordre, eux se révoltèrent. Le romantisme bénéficie donc, au moins potentiellement, d’une audience très vaste, qui peut se définir par toutes les « classes, fractions de classes ou catégories sociales pour lesquelles l’avènement et le développement du capitalisme industriel moderne provoquent un déclin ou une crise de leur statut économique, social ou politique et/ou portent atteinte à leur mode de vie et aux valeurs culturelles auxquelles elles sont attachées ». C’est de cette possibilité unique d’alliance entre des individus issus d’horizons très divers que se sont privés les marxistes en répudiant le romantisme.
Du coup, on pense à l’essai que vient de publier Kristin Ross, Mai 68 et ses vies ultérieures (éditions Complexe/Le Monde diplomatique). Agacée par les chromos qui font de 68 une simple révolte étudiante circonscrite au Quartier Latin, ou une simple révolution des mœurs, Kristin Ross souligne : « [Mai 68] a balayé les catégories et les définitions sociales, réalisé des alliances et des rencontres imprévisibles entre secteurs sociaux et personnes d’origine hétérogène qui ont lutté ensemble pour résoudre leurs problèmes collectivement. Comment un tel mouvement a-t-il pu être reclassé au sein de catégories “sociologiques” aussi restreintes que “milieu étudiant” ou “génération” ? (...) “Les événements de 1968 furent avant tout un refus massif de la part de milliers, voire de millions, de personnes, de continuer à concevoir le social de manière traditionnelle, c’est-à-dire comme un ensemble de catégories séparées et étroites.” » Il semblerait que Michaël Löwy et Robert Sayre aient raison à plus d’un titre lorsqu’ils font de Mai 68 l’une des principales manifestations romantiques - quoique non identifiée comme telle - du XXe siècle...
Une critique du capitalisme
qui prend le mal à la racine
Ils attirent aussi notre attention sur un roman de Charles Dickens tout empreint de sensibilité romantique, Temps difficiles, écrit en 1854 (1), qui illustre bien cette critique d’ensemble du capitalisme - à la fois comme système d’exploitation économique de la classe ouvrière et, plus largement, comme machine de guerre contre toutes les « valeurs qualitatives » - que permet le romantisme. Temps difficiles se déroule dans une ville industrielle imaginaire d’Angleterre, grise et triste, au ciel pollué par la fumée des usines : Coketown. Dans cet univers de désolation, les ouvriers accomplissent un travail monotone et abrutissant, pour un salaire dérisoire (leur patron clame à qui veut l’entendre que si l’on écoutait ces gens-là, ils exigeraient de se nourrir « de potage à la tortue et de venaison avec une cuillère en or »). Mais Dickens accorde au moins autant d’attention - et de verve satirique - à son personnage central, un notable de la ville, Thomas Gradgrind, incarnation de cette raison froide et abstraite, d’essence marchande, dont parle Billeter : pour Thomas Gradgrind, « tout ce qui ne peut s’évaluer en chiffres ou tout ce qui ne peut pas s’acheter au plus bas et se revendre au plus haut n’existe pas et ne doit jamais exister ». Il nie la gratuité, le sentiment, l’imagination : ses enfants n’ont pas le droit de lire des contes ou des romans, ni même d’avoir dans leur chambre des rideaux avec des motifs de petits chevaux, car les seuls chevaux qu’ils doivent voir sont les chevaux réels. Au lieu d’une salle de jeux, il leur a aménagé un laboratoire scientifique. « Dans la vie, on n’a besoin que de faits » : tel est le credo de Thomas Gradgrind. Ses principes éducatifs vont dévaster la vie de sa fille aussi sûrement que l’usine dévaste celle de la jeune ouvrière. La thèse implicite du roman, c’est que, derrière tout cela, il y a un seul et même système.
Impossible, aujourd’hui, de dépoussiérer le romantisme sans s’exposer à des critiques inspirées par les résidus tenaces de la foi aveugle dans le « progrès », mais aussi par une contre-offensive idéologique qui s’est déployée dans les années de l’après-68 sous l’égide des « gauchistes repentis » et autres « nouveaux philosophes ». La tendance est désormais à la glorification sans nuance de la modernité libérale, technologique et consumériste. Parmi les auteurs, cités par Sayre et Löwy, qui, à cette époque, critiquent le romantisme avec le plus de virulence, on trouve Blandine Kriegel, ancienne gauchiste et future intellectuelle chiraquienne, qui « essaie de rendre le romantisme responsable non seulement du totalitarisme de droite (le nazisme), mais également du totalitarisme de gauche (les goulags), par le biais d’une identification totale de Marx avec l’esprit romantique ».
L’invocation romantique du passé :
un mouvement disqualifié
par sa nostalgie ?
Reste qu’il y a une critique, parmi celles le plus fréquemment faites au romantisme, qui mérite un examen particulier : celle qui porte sur son rapport particulier au passé. Son évidente composante nostalgique a souvent permis de le disqualifier en brocardant son idéalisme naïf. Il existe évidemment des courants romantiques réactionnaires, qui répudient en bloc la modernité et rêvent d’un retour au passé pré-capitaliste - retour aussi illusoire que peu souhaitable. Mais on ne croit pas trop se tromper en affirmant qu’ils sont marginaux. Le romantisme est de toute façon « une critique moderne de la modernité », comme l’écrivent Sayre et Löwy, et, en général, il en a parfaitement conscience. Mais, en lisant à la fois Révolte et mélancolie et Chine trois fois muette, on mesure combien la remise en cause de l’hégémonie économique et de la mentalité qui la maintient en place souffre de la période longue sur laquelle elle porte : sous le nom de « modernité », le romantisme s’en prend en fait à la « civilisation engendrée par la révolution industrielle et la généralisation de l’économie de marché » ; sauf que, comme les deux se confondent très largement, il court le risque de voir sa contestation assimilée, ou de l’assimiler lui-même, à un simple regret du passé. Par quel autre moyen que par les références au passé, cependant, pourrait-il tenter de montrer que le système capitaliste n’est pas, comme il le fait croire, l’état « naturel » de l’humanité ? Se perpétuant grâce à cette forme d’inconscience spécifique qu’elle secrète, et que pointe Billeter, la raison marchande, en retour, renforce encore cette inconscience, puisque la longévité de son règne apparaît comme un gage supplémentaire de sa « naturalité » : on voit bien le cercle vicieux qui en résulte.
Pour Billeter, l’exploration de l’histoire, « en nous rendant attentifs au surgissement du nouveau dans le passé, nous dispose en faveur de son apparition dans l’avenir », et peut seule nous sortir de la léthargie où nous plonge la prétendue « fin de l’histoire ». Sayre et Löwy, également, estiment que le détour par le passé est un « outil puissant et subversif de critique et de relativisation de la civilisation occidentale moderne ». Ils citent les réflexions d’Ernst Bloch, qui faisait valoir que « le désir de bonheur ne se peignit jamais dans un avenir vide et totalement nouveau », et qui prônait un rapport créatif au passé, attentif à ce qu’il recelait de promesses non-réalisées : « Les barrières dressées entre l’avenir et le passé s’effondrent ainsi d’elles-mêmes, de l’avenir non devenu devient visible dans le passé, tandis que du passé vengé et recueilli comme un héritage, du passé médiatisé et mené à bien devient visible dans l’avenir. » Ce dialogue constant avec le passé, ce désir de l’interroger, de nous montrer dignes de ceux de nos prédécesseurs qui nous inspirent du respect, n’est-il pas de toute façon préférable à la dictature de l’éphémère et à la perte de mémoire permanente auxquelles nous assigne la société de l’information ?
Inventer
« une forme supérieure de culture »
Révolte et mélancolie, dans sa conclusion, affirme la nécessité d’échapper à la logique binaire qui nous somme de choisir entre « tradition et modernité, retour au passé et acceptation du présent, réaction obscurantiste et progrès dévastateur, collectivisme autoritaire et individualisme possessif, irrationalisme et rationalité technobureaucratique ». Il invite à se projeter dans un avenir qui impliquerait « la conservation des meilleurs acquis de la modernité » en même temps que « son dépassement vers une forme supérieure de culture » : ce serait un chantier compliqué, certes, et qui susciterait bien des débats ; mais il pourrait, par là même, redonner un horizon et un projet politiques à nos sociétés désorientées, qui ne savent plus quoi faire d’elles-mêmes. Sayre et Löwy font surtout remarquer qu’on ne peut plus, aujourd’hui, se débarrasser des romantiques aussi facilement qu’autrefois en les accusant de vouloir ramener l’humanité à l’âge des cavernes, car l’échec du système, l’impasse à laquelle il mène, sont de plus en plus patents ; les ravages qu’il produit augmentent le nombre de ses victimes et diminuent celui de ses bénéficiaires à un rythme infernal : « Tout se passe comme si la civilisation industrielle-capitaliste avait atteint une étape de son développement où ses effets destructeurs sur le tissu social et sur l’environnement naturel ont pris des proportions telles que certains thèmes du romantisme - et certaines formes de nostalgie - exercent une influence sociale diffuse allant bien au-delà des classes ou catégories avec lesquelles il était principalement lié auparavant. »
Billeter est d’accord : cette économie « ne peut plus prétendre apporter aucun progrès. Ce sont au contraire ses effets dévastateurs qui deviennent de plus en plus sensibles dans nos vies, dans nos sociétés, dans le monde entier ». Pour lui, il faut d’abord déjouer les ruses d’un système qui repose largement sur sa capacité à nier sa propre nature « imaginaire et donc révocable » : c’est là, dit-il, le premier pas qu’il faut franchir, un pas « à la fois infime et capital », pour pouvoir ensuite, avec notre intelligence, notre imagination (entendue non pas comme « notre faculté de nous soustraire au réel » mais comme « la capacité que nous avons de lui donner forme ») et l’acuité de notre attention à ce qui surgit, « œuvrer, ne serait-ce que d’une façon lointaine, à la préparation d’un nouveau chapitre de l’histoire ». Car « il n’y aurait jamais eu d’histoire si ce n’était le propre de l’homme de produire du nouveau ».
Le cavalier n’est peut-être pas condamné à porter éternellement sa monture sur ses épaules, et à appeler cela « le progrès »...
(1) A écouter : « La malédiction des chiffres », « L’esprit d’escalier », Arte Radio, 8 juin 2005.
Michaël Löwy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie - Le romantisme à contre-courant de la modernité, Payot, 2005 [1992], 305 pages.
Jean-François Billeter, Chine trois fois muette, Allia, 2000 (réédition en 2006), 150 pages.
Voir aussi : La tyrannie de la réalité, manifeste romantique qui s’ignorait (ou presque) au moment de sa rédaction.
Sur le(s) même(s) sujet(s) dans Périphéries :
- * Le fantôme de l’amiral Nelson sur la place Tahrir - 5 janvier 2011
- * La reconquête de l’imaginaire, mère des batailles - Le progressisme à l’épreuve de la fiction - 16 septembre 2009
- * Struggle for time - A la recherche des heures célestes - 5 octobre 2008
- * Les aveuglements de la lucidité - Retrouver l’Océan, d’Henri Raynal - janvier 2006
- * Le « sentiment océanique » à l’assaut du rationalisme - Traité d’athéologie, de Michel Onfray
La mystique sauvage, de Michel Hulin - mars 2005 - * La tyrannie de la réalité - août 2004
- * Tous des réfugiés sur terre - 25 février 2004
- * « Quitter la terre ferme des certitudes » - Femmes, magie et politique, de Starhawk - juillet 2003
- * « Obscurantisme » - OGM : « Refermer sur l’humanité sa prison technologique et en jeter la clef » - septembre 2001
- * Penser par monts et par vaux - Ecoumène et Médiance, d’Augustin Berque - juin 2001






