Le roman d’une maison, de Rezvani
Le cercle enchanté
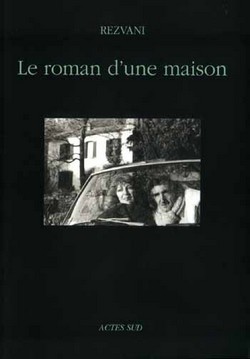 C’est une maisonnette à l’italienne, « un peu plus qu’un cabanon, un peu moins qu’une villa », aux murs peints de couleurs ocre délavées et flanquée d’un palmier. On y accède par des jardins sculptés en terrasses, dans un vallon perdu de la forêt des Maures, dans le Midi de la France. Autour d’elle poussent les cyprès, les mimosas, les châtaigniers, les chênes, les aloès, les yuccas, les romarins arborescents, les roses trémières, les plaqueminiers, les poiriers, les cerisiers, les pruniers... Cette maison aux proportions parfaites, « à la fois modeste et somptueuse », l’écrivain et peintre Serge Rezvani l’habite - au sens le plus fort du terme - avec sa compagne Danièle, dite Lula, depuis quarante ans. Elle s’inscrivait déjà en toile de fond de plusieurs de ses livres, autobiographiques ou non : Les Années-lumière, Les Années Lula, Le testament amoureux... Cette fois, elle occupe le premier plan : « Dans plusieurs de mes livres, j’ai parlé de nous dans cette maison ; j’aimerais maintenant parler de cette maison en nous. » Il n’est pas nécessaire d’être familier de ses précédents ouvrages pour apprécier celui-là : la maison de Rezvani constitue une très belle porte dérobée pour entrer dans son œuvre.
C’est une maisonnette à l’italienne, « un peu plus qu’un cabanon, un peu moins qu’une villa », aux murs peints de couleurs ocre délavées et flanquée d’un palmier. On y accède par des jardins sculptés en terrasses, dans un vallon perdu de la forêt des Maures, dans le Midi de la France. Autour d’elle poussent les cyprès, les mimosas, les châtaigniers, les chênes, les aloès, les yuccas, les romarins arborescents, les roses trémières, les plaqueminiers, les poiriers, les cerisiers, les pruniers... Cette maison aux proportions parfaites, « à la fois modeste et somptueuse », l’écrivain et peintre Serge Rezvani l’habite - au sens le plus fort du terme - avec sa compagne Danièle, dite Lula, depuis quarante ans. Elle s’inscrivait déjà en toile de fond de plusieurs de ses livres, autobiographiques ou non : Les Années-lumière, Les Années Lula, Le testament amoureux... Cette fois, elle occupe le premier plan : « Dans plusieurs de mes livres, j’ai parlé de nous dans cette maison ; j’aimerais maintenant parler de cette maison en nous. » Il n’est pas nécessaire d’être familier de ses précédents ouvrages pour apprécier celui-là : la maison de Rezvani constitue une très belle porte dérobée pour entrer dans son œuvre.
Seuls les magazines de décoration, habituellement, vous font pénétrer dans des maisons étrangères, et traitent - pour un public de non-spécialistes - de la manière dont on habite un espace. Leurs pages sont emplies de demeures de riches, opulentes, soigneusement garnies de meubles de designers célèbres : des maisons apprêtées, ostentatoires, aliénées aux exigences de la compétition sociale, qui trahissent partout le souci d’une totale maîtrise, une volonté de ne rien laisser au hasard. Tout le contraire de La Béate - car tel est le nom prédestiné de la maison de Rezvani : « Cette maison dont je voudrais écrire ici le roman n’a jamais été une “belle maison” ni même de cette sorte de construction dont on se dit qu’elle a été pensée, souhaitée, désirée telle qu’elle est. Non, elle est devenue belle par la façon dont elle a été vécue et dont elle s’est modifiée sans pour cela changer d’aspect. » Elle se rapproche, dit-il, de « certains coquillages simplement beaux pour avoir été sécrétés en innocence par la formulation même du vivant... Comme si le fait d’avoir été l’abri d’une façon d’être et de vivre en son creux avait produit une forme singulière, belle par la nécessaire justesse de sa fonction. » C’est ce lent et subtil travail de mise en forme mutuelle entre le lieu et ses occupants que raconte Le roman d’une maison.
« Les surprises impensées de la vie »
Si la vie de Danièle et Serge Rezvani, comme leur maison, semble si accomplie, c’est qu’ils ne l’ont jamais, elle non plus, « pensée, souhaitée, désirée telle qu’elle est ». En amour aussi, le volontarisme leur est étranger. Quand ils arrivent à La Béate, ils vivent ensemble depuis dix ans déjà. Ils se sont rencontrés en 1950 ; elle avait dix-neuf ans, lui vingt-deux. Ils ne se sont jamais rien promis : d’emblée comblés l’un par l’autre, ils se sont contentés de savourer leur intense bonheur d’être ensemble. Seule cette capacité d’abandon confiant pouvait sans doute permettre au destin de se manifester aussi pleinement. Comme si, heureusement surpris qu’on se soucie si peu de le forcer, il en avait eu les coudée d’autant plus franches...
« Sans doute ai-je déjà tout écrit sur ce nous d’avant la maison, ce nous de nos années cinquante-soixante dont la lutte s’était concentrée exclusivement sur la prise de conscience et le refus de ce que nous ne voulions pas pour rester disponibles à ce que nous ne savions pas, écrit Rezvani. Au contraire de ce que l’on prétend généralement, en effet, savoir ce qu’on veut c’est déjà accepter de limiter sa vie au connu, alors que savoir ce qu’on ne veut pas ouvre sur les surprises impensées de la vie. Bien sûr cela demande certainement beaucoup de courage - osons le mot - car l’édification sociale vous engage à limiter au connu le “sens” de la vie, alors que s’offrent à vous les champs illimités d’une façon d’être et d’exister sans autre modèle que les pulsions secrètes et incernables de votre personnalité. »
Bien qu’isolée au milieu de la forêt, La Béate fait partie de « ces sortes de lieu d’où toute peur est abolie ». Les amoureux y éprouvent une réminiscence de paradis perdu, et ce sentiment de sécurité que peut procurer « le cercle magique d’un espace à votre exacte mesure ». « Aucun bruit ; aucun voisinage ; le village à trois kilomètres ; située au centre de jardins fortifiés d’une architecture nette, elle offrait par son site unique toutes les possibilités de fantaisies à ceux qui voudraient simplement avoir l’enthousiasme de la vivre. » A peine l’ont-ils découverte, invités à dîner un soir par une locataire qui l’occupe pour l’été, que, sous le charme, ils cherchent à la louer à leur tour. Le propriétaire, à qui ils rendent visite en tremblant d’anxiété, car ils n’ont presque pas d’argent, les prend en sympathie. Après deux ans, il décidera de leur vendre la maison ; en fait, il leur en fera pratiquement cadeau, comme s’il s’inclinait devant une évidence. Sans même avoir compris comment, les voilà propriétaires - « moi, l’homme de nulle part et elle qui avait tout quitté pour me suivre nulle part ! »
« L’image du bonheur est révolutionnaire »
Peu à peu, leur vie jusqu’alors vagabonde va devenir indissociable de La Béate, et La Béate, indissociable de leur vie, au point que Rezvani exprime avec force le souhait qu’elle disparaisse, qu’elle parte en flammes après leur mort à tous deux, et qu’il ne reste, pour témoigner de ce qui fut, que ce livre. Pourquoi pas ? On gardera précieusement dans sa bibliothèque cet album-souvenir à la lisière de l’intime et du public (chez Actes Sud, il s’inscrit dans la collection « Archives privées »), ce condensé de volupté ; on le rouvrira de temps en temps pour en relire des passages et en contempler les photos et les dessins avec un émerveillement intact, et se persuader qu’un tel lieu a bien existé. Pourtant, s’il y a une leçon à tirer de cette belle histoire, c’est bien, justement, qu’il n’y a pas de leçon. Lula et Serge Rezvani s’y sont installés, en retrait d’un monde qui ne leur disait déjà rien qui vaille, en 1961. A l’époque, ils n’ont ni eau courante, ni électricité - « mais le lieu à lui seul, par sa beauté, nous met en réelle exaltation ». Sept ans plus tard, ils auront un mal fou à dissiper le malentendu, quand déferleront les hordes de citadins effectuant leur « retour » à la vie rurale. Eux sont là pour des raisons bien plus souterraines que des convictions idéologiques ; ils ne sont pas même là par choix : « Nous n’avions même pas eu à choisir puisque c’était ce lieu hors du temps qui nous avait choisis impérativement. »
Vivant à l’écart du monde, ont-ils pour autant échappé à la politique ? Pas vraiment. Rezvani a écrit du théâtre politique (Capitaine Schelle, Capitaine Eçço, créé en 1971 par Jean-Pierre Vincent au Théâtre National Populaire). Avec une sincérité totale, ils se sont engagés pour certaines causes, parce qu’elles les touchaient aux tripes, ou parce que des militants les avaient appelés à l’aide. Mais l’appel de La Béate et du cercle enchanté qu’elle traçait autour de leur amour a toujours été le plus fort : leur poste d’observation idéal, leur champ d’exploration de la vie, se situaient dans le retrait, et non sur la brèche. C’est là que, pour eux, il y avait à creuser, à créer, à découvrir. Et c’est dans leur égoïsme que réside leur générosité. Dans Le Testament amoureux, Rezvani reproduit une lettre reçue quelque temps après la parution des Années-lumière. Cette lettre, transmise par l’éditeur François Maspero, avait été écrite du fond d’une prison bolivienne, et elle disait ceci :
« Cher Rezvani,
J’avais demandé à ma compagne de vous écrire pour vous dire toute la joie que m’avaient apportée Les Années-lumière, elle n’a pu le faire, cela m’est aujourd’hui possible. Votre bouquin a un effet libérateur, explosive incitation au bonheur, appel à une vie “meilleure”, plus intense, toujours valable même pour ceux qui n’ont plus (ou pas encore) la possibilité d’y accéder. La vie de bohème, bien sûr, est une maladie bourgeoise. Mais le sens de la tendresse, du rire et de l’amertume qu’il y a aujourd’hui au fond du rire nous concernent tous, apprentis révolutionnaires compris. Quand je commence à tourner en rond et à manquer d’air, j’ouvre votre livre et c’est comme une fenêtre sur l’autre côté. L’angoisse s’en va tout de suite. Il est bon de savoir que cela existe !
L’image du bonheur est révolutionnaire, ne serait-ce que parce que seuls des gens physiquement heureux sont en état de transformer leur société et d’accepter tous les sacrifices. L’habit noir, la rancune, le faux col trop serré et le sérieux académique ne pourront jamais être du bon côté. En tournant ces vilaines bêtes, vous nous aiderez à les terrasser, d’abord en nous-mêmes. Condition évidemment pas suffisante, mais nécessaire.
Vive Lula !
Régis Debray. »
Miracle de l’accident
Ce dont l’existence semble solidement ancrée, si bien qu’on ne songe même plus que cela aurait pu ne pas être, relève en fait du plus improbable des concours de circonstances. La Béate est ce minuscule foyer de chaleur et de lumière, perdu en pleine forêt, au cœur de l’obscurité et de la solitude... « Dans l’univers les températures à la surface des astres oscillent entre -273 °C et environ 20 000 °C. Si on figure ce spectre sur une échelle graduée de vingt centimètres, la zone à l’intérieur de laquelle la vie peut s’épanouir ne dépasserait pas un millimètre. Le reste n’étant que glace, désert, mers de lave ou matière en telle surdensification que ses “normes” sont inconcevables à notre imagination. L’isolement du vivant est absolu et nous devons considérer la Terre comme un accident dont nous-mêmes serions l’accident suprême (...). Comment aurions-nous pu imaginer que cette maison, que ces jardins, comme suspendus parmi les châtaigniers millénaires et les vieux chênes, seraient nôtres pendant quarante années, quarante années de réelle félicité ? N’est-ce pas aussi absurde que ce peu de chance donnée au vivant sur l’échelle du spectre universel ? »
Mais ce lieu n’est pas que le refuge de la vie, il est vivant lui-même : la maison, dit Rezvani, « existe en nous à la façon dont peut exister un être vivant - à tel point que chaque fois, en la quittant pour Venise [depuis quelques années, le couple se partage entre Venise et les Maures], c’est une présence vivante que nous avons le sentiment d’abandonner au milieu de la forêt, emportant avec nous le remords de la laisser. » Cet être a même un cœur : une source d’eau fraîche, « notre source dont le bruissement liquide au creux du vallon de La Béate rythme depuis tant d’années notre vie avec la rassurante constance d’un battement de cœur ».
Magie : le mot revient souvent sous la plume de Rezvani. Il n’en trouve pas d’autre, et le lecteur non plus. Autant les croquis de sa main restituent le rayonnement solaire des moments de paresse et de contemplation délicieuses vécus à La Béate (« Je ne fais rien : je vis ! », écrit-il dans son journal), autant les photos, avec le grain sensuel de leur noir et blanc, semblent nimbées d’une sorte de brume, de mystère épais enveloppant les vieilles pierres dissimulées au milieu des branchages. Que la saveur du présent ne soit pas la même là qu’ailleurs, on le croit volontiers. Rezvani reproduit un passage étourdissant du Testament amoureux - il est de la plume de Lula :
 « En ce moment le feu dans la salamandre rougeoie derrière le mica, et les arbres sans feuilles font un dessin rigide à travers le ramage des rideaux transparents. Plus tard cette même chambre s’assombrira des verts de jungle de l’été, les fenêtres s’ouvriront sur les vibrations tendues des cigales... Ce matin il pleut. Il pleut depuis hier. Il pleut comme il pleut dans le Midi, régulièrement, lourdement. Il n’avait pas plu depuis des mois et nous n’avions plus d’eau. Revenus aux temps anciens quand il fallait toujours penser à économiser. Tout à l’heure nous allons enfin pouvoir prendre un merveilleux bain tous les deux dans la salle de bains bien chaude ! Ce matin j’avais la flemme d’écrire mais je me disais que si je ne m’y mets pas un peu chaque jour je n’y croirai jamais assez pour continuer. Déjà hier je m’étais donné l’excuse de faire des gâteaux pour le thé ; la maison est encore tout embaumée de parfum de cannelle et de gingembre. Aujourd’hui je suis tentée de trouver qu’il pleut trop, que c’est sinistre... on n’y voit plus rien par la fenêtre... bien qu’au contraire la chambre n’en paraisse que plus intime, plus chaude avec la lumière des petites cloches en pâte de verre orangée. La chatte dort en boule sur la couverture de fourrure, poil contre poil, petite touffe blonde sur l’immensité fauve. Le feu est rouge à travers le mica de la salamandre et les fleurs du tapis sont douces sous mes pieds... »
« En ce moment le feu dans la salamandre rougeoie derrière le mica, et les arbres sans feuilles font un dessin rigide à travers le ramage des rideaux transparents. Plus tard cette même chambre s’assombrira des verts de jungle de l’été, les fenêtres s’ouvriront sur les vibrations tendues des cigales... Ce matin il pleut. Il pleut depuis hier. Il pleut comme il pleut dans le Midi, régulièrement, lourdement. Il n’avait pas plu depuis des mois et nous n’avions plus d’eau. Revenus aux temps anciens quand il fallait toujours penser à économiser. Tout à l’heure nous allons enfin pouvoir prendre un merveilleux bain tous les deux dans la salle de bains bien chaude ! Ce matin j’avais la flemme d’écrire mais je me disais que si je ne m’y mets pas un peu chaque jour je n’y croirai jamais assez pour continuer. Déjà hier je m’étais donné l’excuse de faire des gâteaux pour le thé ; la maison est encore tout embaumée de parfum de cannelle et de gingembre. Aujourd’hui je suis tentée de trouver qu’il pleut trop, que c’est sinistre... on n’y voit plus rien par la fenêtre... bien qu’au contraire la chambre n’en paraisse que plus intime, plus chaude avec la lumière des petites cloches en pâte de verre orangée. La chatte dort en boule sur la couverture de fourrure, poil contre poil, petite touffe blonde sur l’immensité fauve. Le feu est rouge à travers le mica de la salamandre et les fleurs du tapis sont douces sous mes pieds... »
« Le lieu commun agit sur notre imaginaire
avec une curieuse force »
Le roman de cette Béate est d’un bout à l’autre un récit de bonheur. Bonheur dont le couple a toujours eu, sur l’instant, une conscience aiguë : « Il m’est arrivé, certains soirs, alors que Danièle, tout en lisant, écoutait un quatuor de Beethoven, étendue parmi les coussins du divan de la grande pièce du rez-de-chaussée, la chatte sur les genoux et le chien couché tout de son long à ses pieds, oui, il m’est arrivé souvent de sortir dans la nuit sous les palmes de la terrasse pris soudain d’une sorte d’irrésistible sanglot de ce trop de bonheur. Par la fenêtre restée ouverte, je voyais l’amour de ma vie dans la belle lumière dorée des lampes à pétrole, et je souffrais, le cœur douloureusement étreint de la nostalgie d’un présent si délicat, si juste, dont la sublime beauté n’avait pu se former que pour demeurer suspendue dans l’éternel. Non, la mort ne pourra jamais nous atteindre ici, non jamais elle ne pourra anéantir une telle somme de sereine perfection ! »
Récit de bonheur ? Aux yeux de beaucoup, les termes de l’expression pourraient sembler contradictoires. La surprise que réserve l’écriture de Rezvani, c’est la découverte que, contrairement à ce qu’on croit souvent, il y a énormément à dire sur le bonheur. Mais ce n’est pas le sujet le plus simple ; Rezvani est bien conscient de la difficulté : « Jouir de la vie ne peut se dire avec des mots ! On vit. On pense : “bonheur” ! “félicité” ! On a atteint un état. On se sait aux maximum de la sensation. Pour saisir cet état et le mettre en forme, la palette des mots est pauvre. Il en est bien sûr de même pour le malheur et ses indicibles souffrances. Là aussi les superlatifs s’ajoutant aux superlatifs détruisent le “ce qui ne peut se dire” comme ne peut se dire l’état presque suffocant de cette prise de conscience d’avoir été placé à l’extrême de ce qu’il était possible de vivre. Lisant depuis un certain temps les quelque deux mille pages des Mille et Une Nuits (...), je ne cesse de m’étonner avec ravissement de l’emploi des superlatifs disant le plus que beau, le plus que délicieux, le plus que triste ou le plus que désespéré. En effet, notre langage bute. C’est alors que l’Orient dit : “Il fut étonné à la limite de l’étonnement.” Ou : “Il ressentit telles délices à la limite des délices.” Ou : “De plaisir sa poitrine se dilata à la limite du dilatement.” Ou alors : “De tristesse il sentit sa poitrine se rétrécir à la limite du rétrécissement.” Cette “limite” dit bien, en effet, la limite des mots, et combien au-delà du mot, qui prétend signifier, le lieu commun agit sur notre imaginaire avec une curieuse force. Est-ce arrivé à la “limite” du dire que dans des époques très anciennes le langage s’est brusquement mué en poésie... en musique de mots ? »
La fécondité littéraire du bonheur
En lisant les premières pages, on est subjugué, sans toutefois pouvoir se défaire d’un doute : avec ce qu’on est en train de lire, il a déjà tout dit ; il n’y a rien à dire de plus... Que peut-il bien avoir trouvé à dire encore dans les cent vingt, dans les cent trente pages qui restent ? Et à chaque fois que l’on aborde un nouveau paragraphe, la surprise de cette fécondité littéraire du bonheur se répète : ah ! c’est vrai, il y avait ça à dire, encore... Et comme il fait bien de le dire ! Comme c’est beau ! Il y a à raconter la première impression, la découverte de la maison, son histoire avant que le couple n’en prenne possession, et l’histoire du couple avant que la maison ne prenne possession de lui ; il y a à décrire la configuration du vallon, la végétation, puis la disposition des pièces, les travaux entrepris dans l’euphorie de se savoir définitivement chez soi ; les retours après plusieurs mois d’absence, quand il faut réveiller les lieux endormis, leur réinsuffler la vie... Il y a à parler des relations qui s’établissent avec le monde extérieur, avec les amis (« pas de relations : des amis ! »). Il y a à comparer la différence de perspective quand on écrit sur place ou quand on écrit à distance, depuis Venise, en se fiant aux photos et aux souvenirs... Il y a à constater comment l’influence subtile de la maison et du mode de vie qu’elle induisait a transformé un peintre en écrivain - mais aussi en compositeur : sous le pseudonyme de Bassiak, Rezvani est l’auteur de chansons (reprises en 2000 par la chanteuse Mona Heftre sur un disque, Tantôt rouge, tantôt bleu) dont la plus célèbre est Le Tourbillon, chantée par Jeanne Moreau dans Jules et Jim, avec à la guitare Rezvani lui-même.
La relation symbiotique qui s’est développée entre le couple et la maison est exactement ce qu’Augustin Berque appellerait une « relation écouménale » (« une imprégnation réciproque du lieu et de ce qui s’y trouve »). La Béate est bien ce lieu qui, à la fois « empreinte et matrice », selon les mots du géographe, « accueille et engendre ». Rezvani, sans le savoir, décrit ce processus avec une grande précision :
« Depuis maintenant trente ans que j’écris, pas un instant ne me quitte la sensation d’harmonie que malgré moi mon regard capte à travers les vitres de la porte-fenêtre. Tout en n’ayant pas la conscience précise de le voir, entre chaque mot mon regard va à ce paysage et revient sur ce qui s’écrit pour retourner brièvement sur les beautés du vallon, si bien que cette harmonie, d’année en année, a imprégné toutes les facettes de mes livres. Ce paysage n’est pas un simple paysage. Nous l’avons en quelque sorte sécrété, fait, choisi, sélectionnant sans nous en rendre compte chaque arbre, chaque buisson, presque chaque fleur puisque nous avons délaissé celles qui ne nous plaisaient pas... Comme dans la vie, effectivement, nos choix, cherchant toujours la pente du plaisir, se sont faits non dans un but précis mais en écartant à mesure ce que nous ne tenions pas à devoir vivre, de même avons-nous peu à peu écarté de nos yeux ce qui n’entrait pas, là aussi, dans leur plaisir. »
« Les surprises de la répétition »
Le livre avance ainsi par vagues successives : il avance en partant du même pour sécréter du nouveau. Comme, dans cette vie immobile du couple dans la maison, le présent se superpose au passé (« Etrange expérience que d’écrire sur ce qui a été... tout en étant encore votre vie présente ! »), le récit présent se superpose aux récits anciens à travers les nombreux extraits que Rezvani recopie de ses précédents livres, de ses chansons autobiographiques ou de son journal. Ressassant un étonnement toujours renouvelé, il répète inlassablement la même célébration éblouie ; et pourtant il introduit à tout moment du neuf, par de patients et - a priori - imperceptibles glissements du récit. Dans cette permanence réside le secret d’une « sortie du temps » qui mène « aux confins de tous les plaisirs que l’esprit et le corps peuvent espérer en cette unique réalité qu’avec douleur nous ne savons que terrestre ». Rezvani use avec naturel de cette expression inattendue : « les surprises de la répétition ». A le lire, on comprend mieux l’inanité des poncifs sur les dangers de la « routine » - cette routine qu’il faut conjurer à tout prix dans un couple, ce pour quoi les magazines féminins livrent régulièrement des tombereaux de conseils stratégiques. Et si, dans la répétition, résidait un secret qui resterait entièrement à explorer, sur les traces de ces deux aventuriers dont les rides semblent n’être rien d’autre que des traces de plaisir ?
« Le cœur, les poumons, les viscères, la veille et le sommeil de notre cerveau, le désir et son assouvissement, la faim, la soif, ainsi que les rythmes de la marche... non, rien n’échappe à la répétition ! Et ce n’est que par la répétition et ses variations que nous pouvons juger de notre présence au réel. Même l’amitié se fortifie de la répétition et de ses jeux variés. Et bien sûr l’amour-passion dont le déploiement peut vous entraîner de surprise en surprise, ainsi qu’il est dit des “forêts enchantées” dont on ressort, après y avoir erré mille ans, sans avoir soi-même vieilli. »
Rezvani, Le roman d’une maison, Actes Sud, 2001 (Le testament amoureux est chez Points Seuil).
Sur le(s) même(s) sujet(s) dans Périphéries :
- * Et vous, quel travail feriez-vous si votre revenu était assuré ? - Revenu garanti, « la première vision positive
du XXIe siècle » - décembre 2010 - * Une femme de ressources - Séverine Auffret, philosophe et essayiste - septembre 2005
- * « Une boussole pour des combats dépareillés » - Pour la gratuité, de Jean-Louis Sagot-Duvauroux - mars 2002
- * La subversion par les plantes - Ruines-de-Rome, de Pierre Senges - mars 2002
- * Le Paradis, c’est par où ? - Quand l’utopie insiste - novembre 2000






